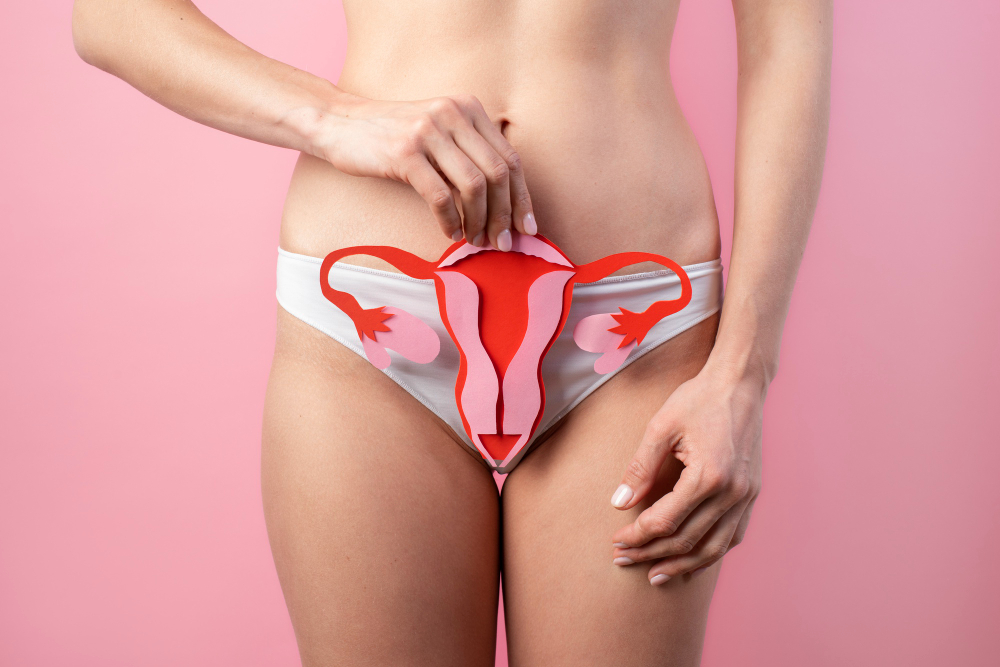Endométriose : comprendre, diagnostiquer et mieux vivre avec cette maladie encore trop méconnue
L’endométriose est une maladie gynécologique chronique qui touche près d’une personne menstruée sur dix. Pourtant, elle reste encore largement sous-diagnostiquée. Douleurs, troubles digestifs, fatigue ou infertilité en sont les manifestations les plus fréquentes. Voici un guide complet pour mieux comprendre l’endométriose, ses symptômes, son diagnostic et les options de traitement disponibles.
Qu’est-ce que l’endométriose ?
Il s’agit d’une maladie inflammatoire chronique, dépendante des œstrogènes. Elle se caractérise par la présence, en dehors de l’utérus, d’un tissu semblable à l’endomètre. Ce tissu réagit aux hormones du cycle menstruel et provoque des inflammations, adhérences ou kystes.
L’endométriose peut se loger sur les ovaires, les trompes, le rectum, la vessie, et plus rarement sur des organes éloignés. Elle impacte la qualité de vie physique, émotionnelle, professionnelle et sexuelle.
Quels sont les symptômes de l’endométriose ?
Les signes varient d’une personne à l’autre. Les plus courants sont :
- Règles très douloureuses (dysménorrhée)
- Douleurs pendant les rapports sexuels (dyspareunie)
- Fatigue chronique
- Troubles digestifs ou urinaires pendant les règles
- Infertilité partielle ou totale
Il existe aussi des formes silencieuses, sans symptômes apparents, ce qui complique le diagnostic.
Quelles sont les causes possibles ?
Les causes exactes restent floues, mais plusieurs pistes sont explorées :
- Menstruations rétrogrades : le sang menstruel remonte dans l’abdomen
- Prédisposition génétique
- Facteurs environnementaux et hormonaux
- Défaillance du système immunitaire
Certains facteurs augmentent le risque : premières règles précoces, cycles courts, antécédents familiaux, etc.
Un diagnostic encore trop long
En moyenne, il faut 7 ans pour diagnostiquer une endométriose en France. Les douleurs sont souvent minimisées ou prises pour de simples règles douloureuses. Le diagnostic repose sur :
- Un interrogatoire médical approfondi
- Une échographie pelvienne ou endovaginale
- Une IRM spécialisée
- Parfois une coelioscopie
Des recherches récentes développent également un test salivaire prometteur.
Les différents types d’endométriose
On distingue plusieurs formes selon la profondeur des lésions :
- Superficielle (péritonéale)
- Ovarienne (endométriome)
- Profonde (atteinte digestive, vésicale, pelvienne)
La douleur ne reflète pas forcément la gravité de la maladie. Une endométriose légère peut être très douloureuse, et inversement.
Quels traitements pour soulager l’endométriose ?
Il n’existe pas encore de traitement curatif. Cependant, plusieurs solutions peuvent soulager les symptômes :
- Médicaments antalgiques : paracétamol, AINS
- Traitements hormonaux : pilule en continu, DIU hormonal, agonistes de la GnRH
- Chirurgie : en cas de kystes, douleurs invalidantes ou infertilité
- Approches complémentaires : kiné, ostéopathie, nutrition, sophrologie
Un suivi multidisciplinaire est recommandé pour adapter les soins à chaque patiente.
Endométriose et fertilité
Environ 30 à 40 % des femmes atteintes rencontrent des problèmes de fertilité. Cela dépend du type et de la localisation de la maladie. Des solutions existent :
- Préservation de la fertilité (congélation d’ovocytes)
- Fécondation in vitro (FIV)
- Chirurgie préalable en cas d’endométriose sévère
Un accompagnement personnalisé avec un spécialiste de la fertilité est essentiel.
Vers une meilleure reconnaissance
L’endométriose a longtemps été ignorée. Depuis quelques années, elle est mieux reconnue par les autorités de santé :
- Intégration dans les ALD (affection longue durée)
- Stratégie nationale en France depuis 2022
- Actions d’associations comme EndoFrance ou Info-Endométriose
Des campagnes de sensibilisation aident à faire évoluer le regard porté sur la maladie.
Conclusion
L’endométriose touche des millions de personnes à travers le monde. Elle reste complexe, mais elle n’est pas sans solutions. En améliorant le diagnostic, en diversifiant les traitements et en brisant les tabous, nous pouvons offrir une meilleure qualité de vie aux personnes concernées. Mieux informer, c’est déjà mieux soigner.